INTERVIEW DE LAURE SALMONA
Par Francine Sporenda

Militante féministe et experte des violences sexuelles et sexistes, Laure Salmona est co-fondatrice et membre du Bureau de l’association Féministes contre le cyberharcèlement. Co-autrice, avec Ketsia Mutombo, de l’ouvrage Politiser les cyberviolences. Une lecture intersectionnelle des inégalités de genre sur Internet aux éditions Le Cavalier Bleu, elle appréhende l’espace numérique à travers le prisme des inégalités de genre pour mieux lutter contre les rapports de domination qui s’y déploient
FS : Vous dites dans votre livre que les réseaux sociaux sont parcourus par les mêmes rapports de force que le reste de la société, et que ce sont les mêmes catégories qui occupent une position dominante en réel qui y accaparent la plus grande partie de l’espace virtuel et en évincent les voix minoritaires. Ces voix minoritaires qui, victimes de cyberharcèlement, doxxing, attaques en meute, etc. finissent par fermer leurs comptes et quitter les RS. Pouvez-vous nous parler de cette silenciation des militantes féministes, antiracistes, etc. sur les RS par le cyberharcèlement ?
LS : Oui, l’espace numérique, qui est un reflet de nos sociétés et où l’on va donc retrouver toutes les oppressions et dominations qui s’y déploient, est aussi devenu un véritable champ de bataille, au sein duquel les cyberviolences servent d’armes aux groupes dominants et conservateurs, leur permettant de museler et de chasser des réseaux sociaux les militant·es qui tentent de renverser les normes établies et de dénoncer les inégalités et discriminations dont iels sont victimes. S’il suffit d’être une femme pour subir des cyberviolences à caractère sexiste, ces violences frappent de manière encore plus intense celles qui militent pour défendre les droits humains et expriment leurs opinions politiques en ligne, car l’enjeu est de les faire taire pour mieux les évincer du débat public. Ainsi les militantes féministes, d’autant plus si elles luttent aussi contre le racisme, les LGBTIQphobies, le validisme, la grossophobie, etc. sont la cible de nombreuses cyberviolences, menaces et intimidations, qui se produisent en ligne mais peuvent, dans 72% des cas, se poursuivre dans l’espace matériel, notamment via des violences physiques et/ou sexuelles pour une victime sur cinq[1]. Ces violences ont aussi de nombreuses conséquences sur la vie et la santé de celles qui en sont victimes, tout comme sur leur liberté d’expression et sur le débat démocratique dans son ensemble, puisqu’elles poussent de nombreuses femmes à s’autocensurer en ligne par crainte des cyberviolences, muselant ainsi tout une frange de la population qui œuvre pour la transformation sociale et l’égalité réelle.
FS : On observe actuellement un backlash contre #metoo et la soi-disant cancel culture, contre des mouvements comme Black Lives Matter, une obsession à droite contre le wokisme, ce qui donnerait à penser que ces mouvements progressistes sont devenus très puissants voire majoritaires—ce qui est loin d’être le cas. Vos commentaires sur le woke et cette obsession anti-woke des médias de droite ?
LS : Internet, en donnant à tous·tes la possibilité d’atteindre une large audience, en particulier à celleux qui n’avaient pas accès à une publicisation via les médias bourgeois traditionnels, a permis la diffusion d’idées nouvelles. La transformation sociale est souvent rendue possible grâce à l’influence de groupes minorés dont les voix réussissent à se faire entendre bien qu’elles soient dissonantes et s’écartent des normes sociales en vigueur. C’est ce qui s’est passé avec des mouvements comme #MeToo ou #BlackLivesMatter : ces voix, par l’écho qu’elles ont pu rencontrer sur le Web, ont mis au jour une communauté de vécus et d’expériences d’oppression et ont porté au point de provoquer un début de prise de conscience du caractère systémique des violences sexuelles et du racisme au sein de nos sociétés. Mais cette prise de conscience, parce qu’elle menace l’ordre établi et donc les privilèges que les groupes dominants tirent de l’oppression et de la discrimination des groupes dominés, suscite l’inquiétude et l’ire des mouvements conservateurs, masculinistes et suprémacistes. Ce mouvement réactionnaire de backlash n’est rien d’autre qu’une tentative d’intimider et de museler les voix des groupes minorés afin de gagner la bataille des idées. Aujourd’hui, le « wokisme » est devenu la nouvelle « théorie du genre » : on assiste ici à un énième phénomène de panique morale orchestré par les tenants d’une droite raciste, sexiste et LGBTIQphobe. Cela pourrait prêter à rire si ça n’avait pas des conséquences aussi désastreuses sur les droits et les libertés des personnes discriminées. On assiste à un retournement pervers par lequel les groupes dominants se posent en victimes et tentent de présenter les luttes et les revendications des groupes minorés comme dangereuses pour la société et la démocratie. Alors que ces groupes ne réclament rien de plus que l’égalité réelle et la fin des atteintes à leurs droits. Quant à la cancel culture, même si ça ne fonctionne pas aussi bien que ce que dénoncent les médias de droite (on voit bien, même depuis #MeToo, qu’être accusé de viol ne ruine que très rarement la carrière d’un homme s’il est puissant) c’est quand même devenu, en quelques années, un outil utilisé par les groupes minorés pour faire reculer l’impunité sociale. Et bien qu’il fonctionne de façon variable selon le réseau et la puissance de ceux qu’il vise, cet outil a des effets indéniables sur la société dans son ensemble. Si la peur ne change pas de camp, elle s’immisce tout de même dans celui des dominants…
FS: Les femmes racisées sont particulièrement victimes de cyberharcèlement. J’avais noté une étude anglaise dont le Guardian s’était fait l’écho, qui signalait que les femmes politiques les plus attaquées sur le net sont les femmes racisées. Vos commentaires ?
LS : Tout comme dans la vie matérielle, être à l’intersection de plusieurs oppressions expose à davantage de violences en ligne, une étude d’Amnesty International datant de 2018 montre d’ailleurs que les femmes noires encourent 84% plus de risques d’être victimes de cyberviolences que les femmes blanches[2]. Et l’enquête réalisée en 2021 par IPSOS pour Féministes contre le cyberharcèlement montre que ce sont 71% des personnes se déclarant racisées qui ont subi des cyberviolences contre 41% de l’ensemble des Français·es[3]. Encore une fois, le Web est un miroir de la société, et il existe un continuum entre les violences sexistes et racistes exercées dans l’espace tangible et celles que l’on constate au sein de l’espace numérique. De même qu’elles subissent davantage de discriminations et de violences que celles qui ne subissent que du sexisme, les femmes d’origine maghrébine, arabe ou asiatique, noires, rroms, musulmanes, juives, handicapées, lesbiennes, bisexuelles, trans, intersexes, pauvres, sans-abri, marginalisées, grosses, etc. vont subir davantage de cyberviolences.
FS : Nous avons toustes constaté à quel point la modération de Facebook et Twitter-X est souvent arbitraire (pas de tétons mais ok pour les images de torture) et beaucoup d’entre nous ont été la cible de bannissements temporaires ou permanents sous des prétextes absurdes, sans possibilité réellement efficace de faire appel, tandis que lorsque nous signalons des images misogynes, pornos ou racistes, seulement 11% des signalements aboutissent à une suppression sur Facebook et 13% sur Twitter-X. Vos commentaires sur cette modération orientée et sur le fait que les algorithmes de modération utilisés par les plateformes sont imprégnés de misogynie et de racisme?
LS : Les plateformes de réseaux sociaux ont, pour la majorité d’entre elles, été conçues par des hommes blancs aisés et états-uniens. Des hommes privilégiés donc, pour qui la sûreté des femmes et des personnes issues de groupes minorés reste un impensé. Et même si cela est susceptible de changer avec la nouvelle réglementation européenne votée via le Digital service act (DSA), ces entrepreneurs ont longtemps brandi à tout-va la liberté d’expression pour justifier le fait de laisser en ligne des discours de haine sexistes, racistes, des appels au viol ou au meurtre, etc. À ce stade, il faudrait parler de liberté d’oppression plutôt que de liberté d’expression… Sur X (anciennement Twitter), il a fallu attendre 2013, soit sept ans après sa création, pour qu’une fonctionnalité permettant de signaler un contenu soit enfin proposée aux internautes. Et cela n’a eu lieu qu’en raison d’une forte pression médiatique consécutive à un raid de cyberharcèlement orchestré à l’encontre d’une militante féministe, Caroline Criado-Perez, à l’initiative d’une pétition pour que le visage de Jane Austen figure sur les billets anglais de 10 livres. Avant l’émergence des plateformes de réseaux sociaux, les forums et autres espaces de discussion en ligne étaient la plupart du temps autogérés et modérés par des internautes. Les règles de modération étaient clairement affichées et celleux qui y contrevenaient pouvaient être banni·es de ces espaces. Même si tout n’était pas parfait, loin de là, les prises de décision étaient plus transparentes.
On peut aujourd’hui déplorer l’opacité des règles de modération des plateformes, mais aussi de la manière dont cette modération est opérée puisque de nombreuses études et fuites de documents internes révèlent que les plateformes mettent en avant, via leurs algorithmes de recommandation, des contenus violents et extrêmes afin d’attirer l’attention des internautes et de générer de l’engagement – contenus qui ont parfois encouragé la commission de massacres et de crimes de haine, notamment contre des minorités persécutées comme les Rohingyas et les Tigréen·nes. Par ailleurs la modération des contenus se fait aussi via l’exploitation de travailleureuses, souvent basé·es dans les pays du Sud, et exposé·es de façon continue à des contenus extrêmement traumatisants et violents, avec des objectifs chiffrés les obligeant à prendre des décisions en quelques secondes alors qu’iels ne parlent parfois pas la même langue ou n’ont pas les mêmes références culturelles que les internautes dont iels modèrent les contenus.
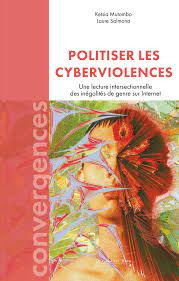
FS : Pouvez-vous nous parler des techniques de « censure invisible » utilisées par des plateformes pour limiter la visibilité des contenus militants ?
LS : Le shadowban est une technique qui consiste à invisibiliser et silencier certain·es utilisateurices en raison des contenus qu’iels partagent notamment lorsqu’il s’agit de contenus militants féministes et antiracistes. De nombreux comptes ont ainsi été shadowban par les plateformes au cours des émeutes qui ont suivi l’assassinat de Nahel Merzouk par un policier en juin dernier. C’est une pratique que les plateformes ont tendance à dissimuler et sur laquelle il n’existe que peu de données hormis les retours d’expérience des internautes visé·es. Nombre de créatrices de contenus militant sur les violences de genre, la santé sexuelle des femmes ou la réduction des risques sont ainsi obligées d’utiliser des subterfuges pour parler de certains sujets : emojis, remplacement de lettres par des chiffres, etc., pour ne pas que leurs contenus et leurs profils soient déréférencés par les algorithmes. Les comptes peuvent être désindexés des moteurs de recherche des plateformes et leurs publications ne plus apparaitre dans les fils d’actualité, les internautes peuvent même être désabonné·es à leur insu des comptes ciblés. Comme le relève Ketsia Mutombo dans notre ouvrage, il est à ce titre intéressant de constater que les hashtags bannis par Instagram ces dernières années font presque tous référence à des sujets communément considérés comme féminins (#girlsonly, #fitnessgirls, #curvygirl…).
FS : Pouvez-vous nous parler du revenge porn et sa large tolérance par les plateformes ?
LS : Cette forme de violence – que nous préférons qualifier de diffusion non consentie de contenu intime pour ne pas reprendre les termes des agresseurs – est largement répandue et vise les femmes dans plus de 90% des cas[4]. Qu’il s’agisse de prises de vues publiées par un ex-partenaire désireux de nuire, de montages visant des actrices ou des femmes politiques, de comptes qui construisent leur notoriété sur la diffusion de contenus dits fisha, ou de deepfakes pornographiques (ces montages crédibles qui deviennent de plus en plus simples à créer avec via des intelligences artificielles génératives), ce sont des violences à la source desquelles on retrouve la même volonté misogyne d’humilier et d’intimider les femmes en leur signifiant que leur corps ne leur appartient pas, il s’agit d’un objet que les hommes peuvent s’approprier, exploiter, commenter, exposer et violenter.
Nous avons créé le collectif Féministes contre le cyberharcèlement en réaction à la large tolérance des plateformes pour ce type de contenu. Fin 2015 sur Twitter, de nombreux comptes dotés d’une large audience capitalisaient sur la diffusion de ce type de contenus pour attirer les followers. Beaucoup de victimes étaient mineures et la plus jeune d’entre elles n’avait que 13 ans au moment de la diffusion. C’est pour dénoncer l’inaction de Twitter que nous avons lancé le hashtag #TwitterAgainstWomen qui a permis d’attirer l’attention des médias et de pointer le caractère systémique des violences de genre sur les réseaux sociaux et l’absence de réaction des plateformes, même lorsqu’il s’agissait de modérer des contenus liés à l’exploitation sexuelle de mineures.
FS : Vous associez masculinité toxique et trolling sur le net. Vos commentaires ?
LS: Je préfère ne pas traiter cette question étant donné que c’est Ketsia qui en parle dans son chapitre et qu’elle n’a pas réussi a trouver le temps de participer aux réponses à cette interview.
FS : Il y a sur le net une manosphère particulièrement bruyante et influente–ForChan, Reddit, Jeuxvidéos–où se retrouvent et échangent incels, masculinistes, racistes, suprémacistes blancs, autour d’un certain nombre de figures, comme Andrew Tate. Vos commentaires sur cette manosphère ?
LS : Bien qu’elles existent sur le Web depuis sa démocratisation, les idéologies masculinistes et misogynes se répandent aujourd’hui de manière fulgurante au sein de la sphère numérique, et ce n’est pas uniquement lié à la manière dont les algorithmes utilisés par les plateformes numériques leur donnent de la visibilité. Portées par différentes communautés en ligne (influenceurs lifestyle, Involuntary celibates (Incels), mais aussi des mouvements plus anciens comme les Pick-up artists (PUA) et les Men going their own way (MGTOW) qui existent depuis les années 1980 et 2000 et des communautés plus spécifiquement françaises formées autour du groupe SOS Papa ou de figures comme Alain Soral ou Eric Zemmour) ces idées sont relayées et farouchement défendues par des armées d’internautes, extrêmement bien organisés et prêts à en découdre pour conserver leurs privilèges de genre, de classe et de race, aidés en cela par le laisser-faire des réseaux sociaux. Car le déficit de modération que nous évoquions tout à l’heure a fait – au nom de la prétendue « liberté d’expression » – de plateformes comme 4chan ou Reddit les terrains de jeu favoris des Incels, masculinistes et suprémacistes blancs.
Les promoteurs des mouvements anti-féministes et masculinistes utilisent de nombreuses plateformes de réseaux sociaux, de Youtube à TikTok, pour accroître leur influence, notamment auprès des jeunes générations, ils usent pour cela d’une rhétorique liée à la sphère du développement personnel et d’un ton humoristique tout en déplorant une prétendue crise de la masculinité, pointant du doigt l’essor des mouvements féministes dont ils seraient les premières victimes. Et cette influence est loin d’être anodine, puisqu’elle a précédemment donné lieu à plusieurs tueries de masse — notamment celles commises par des Incels (Elliot Rodger et Alek Minassian) au nom de leur communauté, mais on peut également citer les attentats commis par Anders Behring Breivik, néofasciste et masculiniste. Ces discours sont pourtant banalisés, au point qu’un acteur comme Vincent Cassel a pu déclarer publiquement à propos d’Andrew Tate : « Il dit beaucoup de choses qui sonnent vraiment problématiques, surtout quand on voit d’où il vient, mais au milieu de tout ça, il dit des choses qui sont réellement intéressantes, parce qu’il veut défendre la masculinité » [5]. N’oublions que l’on parle quand même d’un homme accusé de trafic d’êtres humains… Leur influence s’accentue également dans la sphère politique, et l’on voit de plus en plus de représentant·es de partis d’extrême-droite reprendre leurs éléments de langage. Il y a une intersectionnalité des haines et l’on constate que de nombreuses alliances se forment entre les hérauts des idéologies suprémacistes blanches, LGBTIQphobes, anti-immigration et masculinistes.
FS : Alors que des jeunes filles se sont suicidées suite à des campagnes de cyberharcèlement, le cyberharcèlement est-il réellement puni par la justice ?
LS : L’arsenal législatif existe et permet aujourd’hui de punir les campagnes de cyberharcèlement (depuis 2014), qu’il s’agisse de raids (depuis 2018) ou de cyberharcèlement scolaire (reconnu comme un délit spécifique depuis 2022). Pour autant, la loi reste peu appliquée et l’impunité est quasi-totale. Selon l’étude menée par Ipsos pour notre association en 2022, ce ne sont que 3% des actes de cyberviolences qui font l’objet de poursuites judiciaires. Les raisons sont diverses. Les plaintes sont encore rares : seule une victime sur cinq porte plainte, celles qui n’ont pas porté plainte disent avoir craint que la situation n’empire, qu’elles pensaient que cela ne servirait à rien, ou qu’elles ne savaient pas qu’elles pouvaient porter plainte. Et puis il y a ces chiffres, consternants, qui proviennent de notre enquête de 2021 et révèlent que seules 47% des plaintes donnent lieu à des poursuites judiciaires et que 67% des victimes de cyberviolences qui ont fait la démarche d’aller déposer plainte se sont vues refuser ce dépôt par les forces de police, alors que ce refus est totalement illégal (le personnel de police ne peut refuser de prendre une plainte, c’est illégal, la circulaire du 14 mai 2001, qui est venue préciser l’article 15-3 du code de procédure pénale, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes d’infractions). Sans parler du fait qu’il n’existe aujourd’hui aucune plateforme nationale destinée à l’accompagnement des victimes majeures de cyberharcèlement (pour les victimes mineures il existe le 3018).
FS : Pouvez-vous nous parler de votre association Féministes contre le cyberharcèlement https://www.vscyberh.org/ ?
LS: Féministes contre le cyberharcèlement est un collectif féministe intersectionnel, constitué en association loi de 1901 depuis mai 2017, et mobilisé contre les violences faites aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTIQ+ via les outils numériques. Nos actions sont diverses : sensibiliser à la dimension systémique des cyberviolences de genre et former les professionnel·les, informer notre audience sur les différents rapports d’oppression et de domination, orienter les victimes et les informer sur les recours possibles, réaliser des enquêtes et des campagnes de plaidoyer afin d’améliorer le parcours des victimes, de responsabiliser les plateformes et d’alerter les pouvoirs publics. Sur notre site, nous proposons un guide intitulé « Que faire en cas de cyberviolences et de cyberharcèlement » à destination des personnes victimes de cyberviolences, il est régulièrement mis à jour et contient de nombreuses informations pratiques pour se faire accompagner et porter plainte ainsi que des conseils pour améliorer sa sécurité en ligne. Nous avons aussi créé un guide d’autodéfense à destination des militant·es des droits humains aux côté des associations Vox Public et Citizen for Europe : Nos voix, nos combats.
NOTES
(1) Féministes contre le cyberharcèlement & IPSOS, Cyberviolence et cyberharcèlement : le vécu des victimes, France, novembre 2022. https://www.vscyberh.org/post/703656478851153920/enquetecyberviolences-vecu-victimes
(2)https://decoders.amnesty.org/projects/troll-patrol/findings
(3) Féministes contre le cyberharcèlement & IPSOS, Cyberviolence et cyberharcèlement : état des lieux d’un phénomène répandu, France, novembre 2021. https://www.vscyberh.org/post/675661834715561984/enquetecyberviolencesipsos2021
(4) Carolyn A. ULH, Katlin J. RHYNER, et al. « An examination of nonconsensual pornography websites. », Feminism & Psychology, Vol. 28 (1), 2018, pp. 50–68. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0959353517720225



Les commentaires sont fermés.