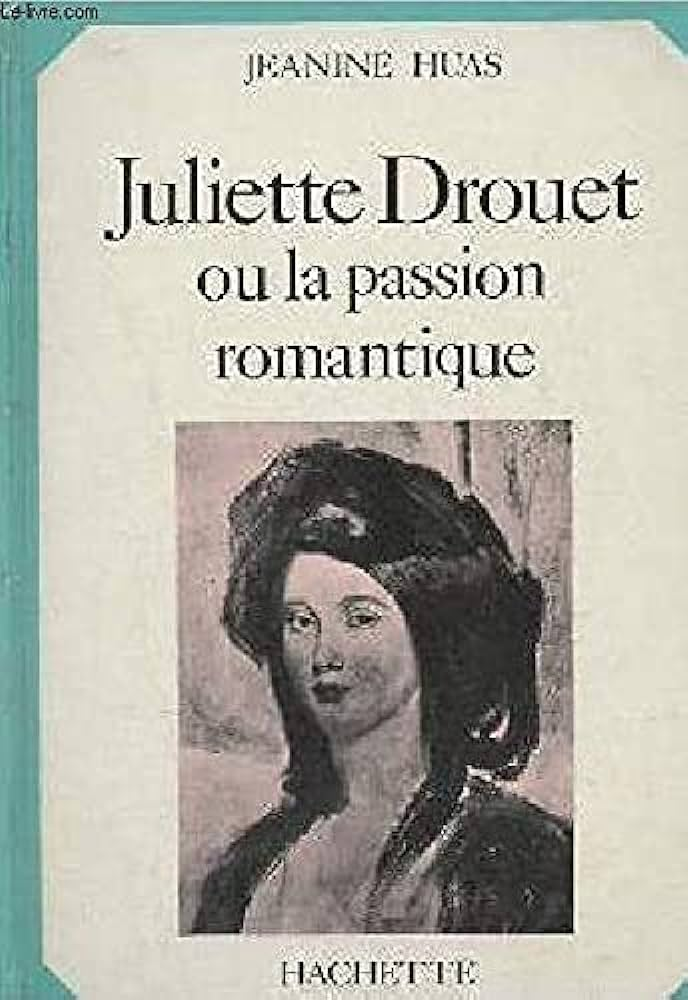PAR FRANCINE SPORENDA
On voit souvent passer des citations de Victor Hugo sur les réseaux sociaux, et de ces citations vous avez sans doute conclu que l’écrivain était un ardent avocat du droit à l’instruction pour le peuple (« celui qui ouvre une porte d’école ferme une prison »), un Républicain indomptable face au pouvoir des rois et de « Napoléon le Petit », opinion qui lui a valu de vivre une grande partie de sa vie en exil (« le roi ne lâche que quand le peuple arrache »), un défenseur des pauvres et des opprimés et un progressiste convaincu dénonçant éloquemment les abus des nantis (« c’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches »), quasiment un socialiste révolutionnaire (« le plus excellent symbole du peuple, c’est le pavé. On marche dessus jusqu’à ce qu’il vous tombe sur la tête »). Un grand humaniste, généreux, philanthrope, apôtre de la fraternité humaine, en lutte contre toutes les injustices et qui a payé cher d’avoir toujours vécu selon ses convictions.
Et un allié féministe engagé, qui a mis sa plume au service de la dénonciation des violences et inégalités criantes que subissaient les femmes à son époque : prostitution (« on dit que l’esclavage a disparu de la civilisation européenne. C’est une erreur, il existe toujours mais il ne pèse plus que sur la femme, et il s’appelle prostitution »), l’inégalité des droits (« une moitié de l’humanité est hors de l’espèce humaine, il faut l‘y faire entrer : donner pour contrepoid au droit de l’homme le droit de la femme »), la mort civile des femmes, le fait qu’elles ne sont pas des citoyennes et n’ont pas le droit de voter (« dans notre législation telle qu’elle est, la femme ne possède pas, elle n’este pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n’est pas. Il y a des citoyens, il n’y a pas de citoyennes, c’est là un état violent, il faut qu’il cesse »). Et qu’il s’était fixé pour tâche de mettre son œuvre au service de cette grande cause (« tout mon théâtre tend à la dignification de la femme. Mon plaidoyer pour la femme est (…) ancien et persévérant et n’a pas de solution de continuité »).
Quel homme admirable, quelle grande conscience, quel allié précieux de la cause féministe avez-vous pensé. Le problème est que le comportement privé de Victor Hugo avec les femmes est aux antipodes de ses déclarations publiques.
La vie sexuelle de l’auteur des « Misérables » a commencé sous d’austères auspices : tombé amoureux de sa voisine et camarade de jeux parisienne Adèle Foucher (les parents Hugo étaient amis des parents Foucher) Hugo, qui commence à gagner un peu d’argent (des pensions royales) grâce à ses poèmes, demande sa main et au bout de 3 ans finit par l’obtenir : il l’épouse en 1822 à l’âge de 20 ans (elle en a 19). Selon ses biographes, il voulut se garder pour Adèle, lui offrir son pucelage. C’est assez inhabituel pour l’époque : si arriver vierge au mariage était un impératif pour les jeunes filles de bonne famille au 19ème siècle, les jeunes hommes devaient en principe posséder une expertise sexuelle afin de pouvoir jouer correctement leur rôle d’initiateur au soir de leurs noces. Cette expertise sexuelle, ils l’acquéraient habituellement au bordel, entraînés par leurs amis ou leur père ou grâce aux « amours ancillaires » c’est-à-dire en couchant avec les servantes de la famille.
Apparemment, Victor Hugo ne voulut pas recourir à de tels expédients et serait arrivé vierge au mariage. Il semble néanmoins avoir été très satisfait de ses performances lors de la nuit initiatique puisqu’il s’est vanté plus tard d’avoir eu neuf rapports sexuels avec sa jeune épouse. Même si on peut suspecter qu’il fanfaronne et que le chiffre réel ait été sensiblement inférieur, cette nuit de noces fut indéniablement une nuit d’horreur pour Adèle, qui a confié plus tard à son amant Sainte-Beuve que, épuisée, sanglante, déchirée, elle se débattit en vain pour échapper aux assauts répétés de Victor et, réduite à l’impuissance par « les bras de fer » qui l’immobilisaient, elle finit par s’évanouir (Bassalah 24). Comme l’écrit Michel de Decker, Adèle « attendait Don Juan, elle rencontra Priape » (De Decker 73).
Il semble que ces rapports sexuels imposés, que l’on nommerait de nos jours « viol conjugal », continuèrent de plus belle : en un peu plus de 7 ans, entre son mariage en 1822 et 1830, Hugo fit cinq enfants à l’infortunée Adèle : Léopold, né en 1823, 9 mois pile après le mariage, mourut au bout de quelques mois, Léopoldine naquit en 1824, Charles en 1826, François-Victor en 1828 et Adèle en 1830. A la suite de quoi, épuisée par ses maternités rapprochées et les assauts quotidiens de l’inlassable Victor (« l’homme possède une clé avec laquelle il remonte sa femme toutes les vingt-quatre heures » écrit-il) (De Decker 73), l’épouse décida de faire chambre à part et mit fin à leur vie sexuelle.
A sa vie sexuelle avec lui, mais pas à sa vie sexuelle avec son amant, l’écrivain et critique littéraire Pierre-Augustin Sainte-Beuve, de 2 ans plus jeune qu’elle, un vilain rouquin, petit, contrefait mais dont la douceur et la timidité contrastaient agréablement avec la brutalité hugolienne. Sainte-Beuve, qui habitait avec sa mère, souffrait en outre d’une malformation du pénis (hypospadias) dont il avait honte. Dégoûtée du stakhanovisme sexuel de son époux, Adèle trouva sans doute en Sainte-Beuve tout ce que Hugo n’était pas : un amant patient et attentionné.
Les Hugo et Sainte-Beuve étaient amis, au début Victor ne se doute de rien, et Sainte-Beuve a des scrupules à trahir ainsi leur amitié. Il tergiverse, il s’éloigne pour ne pas succomber à la tentation, mais il revient, l’inévitable a lieu, et le mari d’Adèle finit par apprendre qu’il est cocu. Il n’en dit rien à personne mais s’en montre très humilié. S’estimant désormais libéré de ses vœux conjugaux, il inaugure la longue série de ses incartades adultérines par une aventure avec une jeune femme, Julie Duvidal (qui épousera peu après Abel Hugo, son frère), se console avec l’écriture et pond des liasses de pages : après « Notre-Dame de Paris », le recueil de poésies «Feuilles d’automne », la pièce de théâtre « Le roi s’amuse » (1832), il monte une nouvelle pièce, « Lucrèce Borgia », au théâtre de la Porte Saint-Martin qui sera jouée en février 1833.
C’est alors qu’il rencontre une jeune actrice de 23 ans, Juliette Drouet, une des comédiennes attitrées du théâtre. Impressionné par sa beauté, et bien que ses références de comédienne soient plutôt minces (elle est plus connue pour avoir été entretenue par une série de personnages richissimes que par ses succès sur scène), il lui propose un petit rôle dans sa pièce, celui de la princesse Négroni. Peu après la première de la représentation, ils deviennent amants. Contrairement à la froide Adèle (avec lui), Juliette a un tempérament de feu et leur première nuit est une révélation pour elle comme pour lui. Mais tout de suite, Hugo se montre jaloux de son passé de semi-courtisane : il la questionne sur ses ex-amants, veut savoir d’où vient l’argent qui paye ses toilettes et son grand train de vie, que ses modestes gains de comédienne ne peuvent expliquer. Il ne veut pas la partager avec de généreux donateurs, il ne veut pas qu’elle s’expose aux regards concupiscents des mâles sur scène, elle doit abandonner le théâtre et rompre avec ses amants sponsors. Il lui met le marché en main, il l’entretiendra mais elle doit renoncer totalement à sa vie passée pour lui : c’est la « réclusion amoureuse » ou rien.
C’est ainsi que commence une liaison backstreet qui durera plus de 50 ans et ne s’achèvera qu’avec la mort de Juliette. Presque tous ses biographes et ceux de Victor Hugo la qualifient d’« histoire d’amour du siècle », de « passion romantique », de « dévotion éternelle », de « pacte de fidélité pour la vie » que nul aléa, nulle tromperie n’a pu briser. En fait, ce que l’on sait des interactions de Drouet et d’Hugo, en particulier d’après la correspondance-fleuve qu’ils ont échangée, évoque plutôt une relation d’emprise et des rapports fortement teintés de sadomasochisme entre l’écrivain et l’actrice, le tyrannique Hugo étant évidemment casté dans le rôle du dominateur.
Certes, il l’installe dans une série de petits appartements, pas très loin de chez lui pour la commodité, et paie son loyer mais il lui interdit d’en sortir, il la séquestre. Même quand elle demande à aller voir la fille qu’elle a eue d’un précédent amant, le sculpteur James Pradier, permission refusée. Il lui interdit aussi d’ouvrir les lettres qu’elle reçoit, même celles de la nourrice de sa fille qui lui en donne régulièrement des nouvelles, c’est lui qui ouvre et filtre son courrier. Pour qu’elle n’ait pas besoin de sortir, il engage à ses frais Marie, une domestique qui fait ses courses—et qui lui rend compte des moindre faits et gestes de sa maîtresse, qui épluche ses comptes, surveille ses dépenses et discute avec elle « de la nécessité d’acheter un balai ou un tablier neuf » (Troyat 124). Juliette se rebelle et fait valoir qu’« elle use sa vie dans une chambre de 12 pieds carrés (…) Ce que je veux (…) c’est la liberté d’agir, la liberté d’occuper mon temps et mes forces » (De Decker 106).
Régulièrement, elle renouvelle ses doléances dans ses lettres : « je n’en peux plus d’être votre prisonnière de guerre et de paix. Et encore si j’avais un préau, un champ, un jardin un endroit quelconque pour prendre l’air et exercer mes jambes, je ne dirais rien ! Mais avoir pour tout exercice que le coin de son feu, d’autre arbre que le tuyau de son poêle et d’autre soleil que la lampe Casul, ça n’est vraiment pas assez pour prendre avec patience vos absences prolongées » (De Decker 132-133). Mais Hugo n’en a cure et lui refuse toujours non seulement le droit de jouer sur une scène, même dans ses pièces, mais le droit de quitter l’appartement sans son accord. Bien plus tard, magnanime, il lui louera une maison avec un petit jardin : Juliette, avant Marcel Proust, dans le rôle de « La prisonnière », le seul que lui autorise Victor. Cette « claustration anachronique, quasi-médiévale » qu’il lui impose durera plus de 12 ans, et c’est seulement quand, à ses yeux, la Juliette de 35 ans sera vieille et qu’il ne la désire plus qu’il y mettra fin.
Et il est si radin, il l’entretient si chichement que Juliette se plaint de ne pas avoir assez d’argent pour se chauffer et pour se nourrir : « jamais de viande quand elle est seule, elle déjeune d’un verre de lait et d’un œuf (…), le soir un morceau de fromage, du pain et un fruit », « il fait froid dans sa chambre et elle vit dans son lit » (Troyat 123). Il lui impose de tenir rigoureusement ses comptes, les vérifie pointilleusement, l’oblige à justifier la moindre de ses dépenses et râle quand il paie ses factures. Comme elle ne sort pas de chez elle, elle n’a plus besoin de belles toilettes, n’a de toute façon pas assez d’argent pour en acheter et est réduite à retaper ses vieilles robes.
Dès le début, leur liaison est orageuse, Juliette renâcle parfois sous le joug, fait des scènes, tempête, pleure, annonce théâtralement leur rupture : « adieu pour toujours… », s’enfuit. Elle prend une diligence pour Saumur, la Bretagne (sa province d’origine), la Belgique, n’importe où loin de lui. Il la rattrape (ou la fait rattraper), l’inonde de protestations d’amour en prose ou en vers, lui jure de changer et de ne plus jamais la tromper, et elle revient. Elle pardonne, pleure de nouveau, se confond en excuses pour son accès d’humeur et rampe devant lui : « si aujourd’hui tu me refuses ton amour, je te demanderai à genoux d’être ton chien, ton esclave… », « mon Victor, je t’aime, je voudrais baiser tes pieds… » (De Decker 97, 136). Et elle n’a pas sitôt le dos tourné que son Toto la trompe de nouveau. Juliette, qui pardonne tout à celui qu’elle vénère comme un Dieu, est une de ces femmes dont les machistes prétendent qu’« elles aiment ça »…
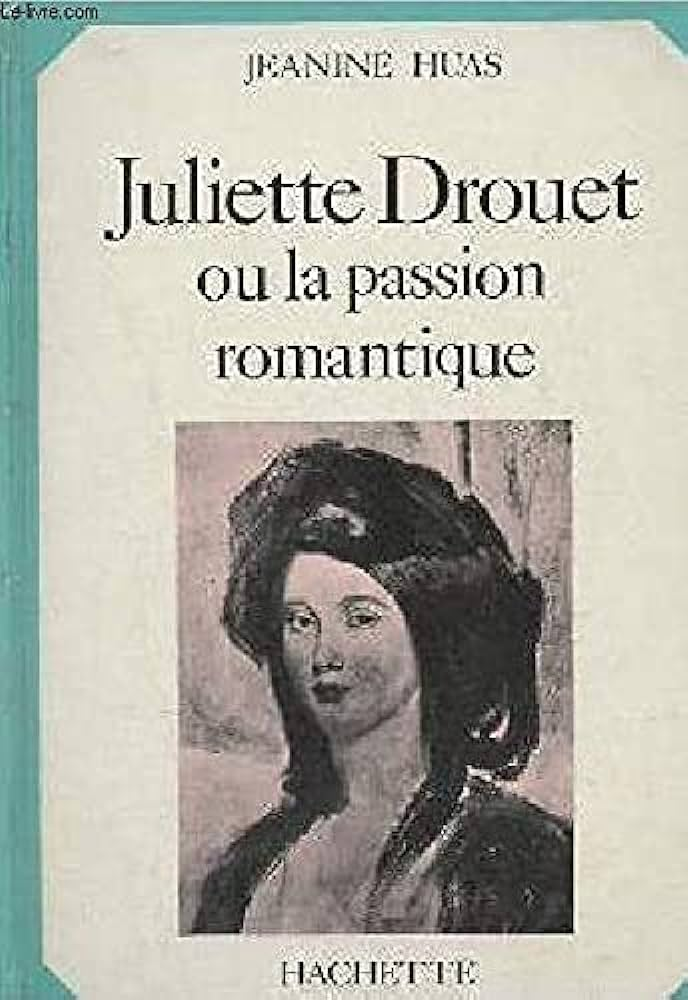
Cette comédie sado-maso s’est répétée environ une dizaine de fois au cours de leur liaison, Hugo lui ayant donné d’abondantes raisons de la jouer et de la rejouer : défilé ininterrompu de jeunes femmes dans son lit, refus d’être vu dans des réceptions et cérémonies officielles ou même dans la rue avec elle ; quand ils prennent le bateau pour rallier sa résidence anglaise, il lui demande de rester à distance et de faire comme si elle ne le connaissait pas. Accaparé par ses activités politiques, ses fonctions à l’Académie française et son travail d’écrivain, il la néglige, ne vient la voir qu’en coup de vent. Et refuse évidemment d’abandonner Adèle, par souci de respectabilité bourgeoise, et pour ses enfants (ce n’est que longtemps après la mort d’Adèle et à la toute fin de sa vie que Juliette pourra enfin vivre avec son amant dans la résidence qu’il a achetée avenue d’Eylau à Paris, maintenant avenue Victor Hugo).
Devant ces ruptures et de réconciliation à répétition, on peut se demander si la principale raison de la durabilité de leur liaison, nonobstant les constantes avanies qu’Hugo a infligées à Juliette Drouet, n’est pas justement que ces montagnes russes émotionnelles en ont été le piment, que s’est développé entre eux ce qu’on appellerait aujourd’hui un lien de trauma bonding, maintenant ainsi une certaine excitation dans une relation où sans cela se seraient installées la routine et l’ennui : abuser de l’amour inconditionnel de Juliette, lui mentir effrontément et la manipuler par ses protestations d’amour, savoir qu’elle était absolument sa chose et accepterait tout de lui a pu être pour lui une raison de revenir à elle, en plus du soutien et l’apaisement qu’elle lui dispensait et des menus services qu’elle lui rendait. Le comportement tantôt inutilement « pétardier », tantôt servile de Juliette interroge : qu’est-ce qui peut expliquer une telle compulsive servilité ? Mais comment une jeune femme de milieu populaire, bretonne originaire de Fougères dont le père était un petit tailleur local et orpheline très jeune pouvait-elle ne pas être éblouie, subjuguée, écrasée par Hugo, né bourgeois, comte (de fraîche date, son père avait été promu général par Napoléon et comte par le très provisoire roi d’Espagne Joseph Bonaparte, mais son grand-père était menuisier), célèbre, riche, comblé d’honneurs ? Et quels traumas a pu subir l’orpheline bretonne passée de main en main (couvent, vieil oncle) comme l’orpheline américaine Norma Jean Baker, future Marilyn Monroe? Les biographes n’en disent rien.
« Comment ne vois-tu pas que tout ce que je fais, même le mal que je te fais, c’est de l’amour », lui écrit Hugo : faire du mal aux femmes, les hommes comme lui appellent ça les aimer, le sadisme, c’est de l’amour (De Decker 103). L’écrivain est un « monstre d’égoïsme » dont l’amour carnivore n’a pas porté chance à ses proches : Eugène son frère, mort fou, Adèle sa femme, morte avant lui, tous ses enfants morts avant lui sauf Adèle, l’Adèle H. de Truffaut, folle et ayant fini à l’asile après un parcours de vie qui évoque celui de Camille Claudel, Juliette Drouet, morte avant lui : une « famille tragique » ont écrit les Goncourt. Une photo qui figure dans le « Juliette Drouet » d’Henri Troyat est révélatrice : prise quelque temps avant la mort de Juliette, celle-ci y apparait comme une très vieille femme, beaucoup plus vieille que son Toto assis à côté d’elle bien qu’elle ait deux ans de moins que lui. Non seulement plus vieille mais usée, vaincue, lessivée, vidée alors qu’Hugo, robuste vieillard, dégage encore une puissante énergie. Qu’est devenue la jeune femme pleine de vie, l’apprentie comédienne riante, espiègle, sensuelle ? Les féministes disent qu’en patriarcat, les hommes se nourrissent des énergies féminines… Hugo, vampire de son entourage ?
Au bout de quelques années, la sexualité intense sur laquelle avait démarré leur histoire s’étiole et disparait peu à peu. De la part d’Hugo seulement : Drouet reste très demandeuse et se plaint amèrement et répétitivement de ne plus être « honorée » (comme on disait bizarrement à l’époque) par son amant. « Mais baise-moi, baise-moi donc vieux cochon de salaud … » lui écrit-elle (De Decker 133), anticipant Virginie Despentes. Mais Hugo n’est pas intéressé par une femme dans la trentaine, il veut des tendrons, l’ogre n’aime que la chair fraîche : dans la très longue liste de ses conquêtes (qu’on est loin d’avoir toutes pu identifier), on relève des nymphettes à peine adolescentes : ainsi la propre sœur de sa femme, Julie Foucher, âgée de 14 ans lorsqu’il la dévirginise en 1836 dans la maison qu’il a louée près de Saint-Germain en Laye (De Decker 108). Pas besoin qu’elles soient jolies, peu importe qu’elles aient un physique ordinaire, du moment qu’elles soient jeunes, de plus en plus jeunes à mesure qu’il vieillit, Hugo prend tout. Il ne cache pas ses préférences : « j’aime les jeunes femmes, non les vieilles. Je ne suis pas bouquiniste en amour » (De Decker 162).
Et la triste Juliette se morfond, désespérée qu’Hugo ne la traite plus comme une maîtresse mais comme une servante : de sa belle écriture, elle recopie et met au propre ses manuscrits, elle ravaude « avec amour » ses chemises et ses chaussettes. Tout au plus accepte-t-il qu’elle lui fasse de temps en temps une fellation. Beau parleur, il l’amadoue en l’assurant que les autres ont sa chair mais qu’elle a son âme–Juliette voudrait davantage. Lors du coup d’Etat du 2 décembre 1851, il proteste bruyamment, s’agite, palabre sur les barricades et tente de mobiliser les foules pour faire obstacle au coup de force de Napoléon III : Juliette a peur pour lui, sa tête est mise à prix, il doit s’enfuir pour échapper à la police. C’est elle qui le cache, lui procure le faux passeport, celui d’un ouvrier typographe dont elle connaissait la femme, qui lui permettra de se mettre à l’abri en Belgique et qui lui sauve la vie (De Decker 177-178). Hugo ne lui en saura aucun gré et continuera à la tromper abondamment et à la traiter comme une domestique.
Car le lit du grand homme est un lieu de passage, une gare, un boulevard : admiratrices, jeunes comédiennes en quête de rôles, servantes, celles de sa femme en particulier, commerçantes, ex-Communardes menacées d’arrestation en quête de protection (c’est le cas de Louise Michel), femmes en grande détresse financière, quelques bourgeoises, mondaines (vicomtesse du Vallon) ou demi-mondaines (Esther Guimont), et même une voleuse juste sortie de prison (Hélène Gaussin) (Kahn 215); Hugo les dépanne volontiers mais ses générosités ne sont jamais désintéressées : il s’agit toujours de quid pro quo, Hugo ne donne rien sans rien et ne connait que l’échange économico-sexuel–à chaque fois, l’ogre prélève sa dime.
Et méticuleux jusque dans ses désordres, il note tout sur ses carnets intimes : les noms des femmes ajoutées à son tableau de chasse, les actes sexuels pratiqués avec elles, les sommes qu’il leur donne, les dates, le tout dans un bizarre langage codé, censé être indéchiffrable pour sa femme ou Juliette, néanmoins relativement transparent. Dans ce langage codé, une espèce d’espagnol ou de latin bâtardisé (Hugo a vécu en Espagne avec sa mère et son père, durant l’occupation de ce pays par les troupes napoléoniennes), « toda » (toute) signifie que le séducteur a « conclu», « Suisse » signale qu’il a vu ou touché la poitrine de sa conquête, les évidents « cave », forêt », « fond du ravin » ne nécessitent pas d’explications, « l’ermite » signifie le pucelage (les servantes avec qui il a des rapports sexuels sont jeunes, voire très jeunes et parfois vierges).
On lit ainsi à propos d’une certaine Elise Grapillot « esta manana, toda » (ce matin, toute). Une Anne lui offre une « nouvelle vue de Suisse », il note avoir « vu la forêt et le ravin de Tombertanne (Anne Tatton) et d’avoir « revu la forêt et le ravin de Riette-Clanche » (Mariette Leclanche). Il enregistre son succès auprès d’une « natte à lit », il baptise une Anne du nom de « Baudet » puis « Bouric » : Hugo invente des surnoms, les prénoms sont déguisés, transformés en noms de lieux ou masculinisés. Et à chaque fois ses dépenses érotiques sont consignées scrupuleusement : la fourchette va de 1 Franc pour quelques tripotages à 5 Franc pour « la totale »–pour donner une idée de ce que cela représente à l’époque, sa femme Adèle paie sa femme de chambre 4 Francs par semaine (De Decker 206-207). Il consigne ce défilé de prénoms dans ses carnets jusqu’à plus de 80 ans.
ACTRICES
Rien ne l’arrête : il séduit la maîtresse de son fils Charles, l’actrice Alice Ozy en lui promettant un rôle dans sa pièce « Le roi s’amuse » et la lui enlève. Charles s’efface, ne se jugeant pas de taille à rivaliser avec son père. Il couche avec les maîtresses de ses amis et confrères, des biographes rapportent qu’il aurait été l’amant de l’actrice Marie Dorval, maîtresse d’Alfred de Vigny ; idem pour Sarah Bernhardt avant qu’elle ne devienne une star. Et il drague aussi bien les gommeuses de vaudeville (Joséphine Faville) que les sociétaires de la Comédie française (Mademoiselle Plessy) (Kahn, 214).
SERVANTES
Les servantes représentent un fort contingent des partenaires sexuelles d’Hugo, peut-être le plus important. D’après son biographe Michel de Decker, il n’aurait commencé à pratiquer le « troussage de domestiques » (comme le disait élégamment Jean-François Kahn à propos de DSK) que relativement tard, lors de son installation à Jersey, et l’élue aurait été une blanchisseuse, « la première d’une interminable série » (De Decker 188). Ensuite il a enchaîné les amours ancillaires, c’est devenu chez lui une véritable addiction : au tout début de son emménagement à Guernesey où il s’installa après avoir été déclaré indésirable à Jersey à cause de ses activités politiques, il consomme pas moins d’une quinzaine de « friandises occasionnelles » (De Decker 194) comme il les appelle. Les Maria, Coelina, Catherine, Mariette, Sophie, Constance, Marie, Fanny, Paulette, Hélène, Charlotte, Désirée, Julie, Victoire, Justine, Louise, Rosalie, Esther, Philomène, Augustine, Marianne, Jeannette etc. défilent dans la « chambre d’à côté » : Hugo, soucieux de son confort, réserve la chambre qui jouxte la sienne à une servante, l’explication à usage familial de cette habitude étant que le patriarche peut, vu son grand âge, avoir besoin d’aide pendant la nuit, d’un verre d’eau ou autre service (Besson 393).
En fait les services que ces servantes rendent au vénérable vieillard sont de nature sexuelle, et l’une chasse l’autre en succession rapide : Hugo note sur son carnet : « Coelina a couché pour la dernière fois dans la chambre d’à côté » (De Decker 208) ; en fait, Coelina est morte. Et le soir même, Hugo installe une Jeanne, sa remplaçante, dans cette commode « chambre d’à côté » (De Decker 209). Curieusement, l’écrivain semble être particulièrement attiré par les domestiques de son épouse, « il séduit la plupart des petites bonnes engagées par sa femme » (Besson 397), on note en particulier une Eva à qui, parce qu’il ne peut pas l’installer dans « la chambre d’à côté » (elle dort à proximité de la chambre de sa femme dont elle est la femme de chambre), il donne rendez-vous sur la plage, n’hésitant pas à escalader des rochers escarpés pour la retrouver.
Goujat, brute, affreux bourgeois prédateur qui profite de la vulnérabilité de femmes prolétaires Hugo ? Pas du tout (à ses yeux) puisqu’il a la délicatesse de toujours glisser quelques Francs dans la poche de ces dames (De Decker 191). Et summum d’hypocrisie, il note ces dépenses érotiques sous la rubrique « bienfaits », camouflage assez crédible puisque l’écrivain peut se montrer généreux sans contrepartie du moment qu’il s’agit de nécessiteux de sexe masculin. Inévitablement, certaines de ces domestiques sont renvoyées de la maison Hugo parce qu’elles sont enceintes…
PROSTITUEES
Et bien sûr, il y a toujours les prostituées, dont ce dénonciateur de la prostitution fait une consommation effrénée. Dès qu’il arrive dans une nouvelle ville, un nouveau pays, il se renseigne immédiatement, entre hommes, sur les meilleurs bordels du coin. Quand il débarque en Belgique, où il doit s’exiler après le coup d’Etat du 2 décembre, on lui dit qu’il y a à Bruxelles, rue de Combras, un bordel peuplé de jeunes et jolies filles qui a été fréquenté –preuve du sérieux de l’établissement–par Guillaume, le feu roi des Pays-Bas : il s’y rend le soir même du jour où il régularise sa situation auprès des autorités belges (Besson 370). Mais il ne s’arrête pas là, il découvre progressivement les ressources de la capitale belge en matière de lupanars, dont il devient un véritable expert. Quand il est à Guernesey, il fréquente les prostituées des rues chaudes de Saint-Pierre-Port qu’il retrouve aussi sur la plage de Fermain Bay (Besson 423). Et bien sûr, quand il peut rentrer à Paris à la chute de l’Empire, il n’a que l’embarras du choix.
FEMMES EN DETRESSE
Hugo a « aidé » et soutenu des femmes recherchées par la police impériale pour leurs activités politiques. La plus connue est Louise Michel, la « vierge rouge », à qui il aurait fait un enfant, Victorine, née en 1852 à Cherbourg, une des nombreuses progénitures adultérines dont il a été le géniteur (le mot de père n’est pas approprié étant donné qu’il ne s’en est pas du tout occupé) ; le fait que cette Victorine soit la fille d’Hugo n’a été mentionné que récemment par ses biographes (De Decker 176). Certes les relations Hugo-Michel, qui commencent bien avant la Commune, paraissent avoir été consensuelles, l’apprentie institutrice semble même être tombée amoureuse de son mentor mais il y a chez l’écrivain une tendance répétitive à s’intéresser aux femmes en détresse, à s’apitoyer sur elles, à les réconforter paternellement… pour finir invariablement par forniquer avec elles. C’est aussi le cas de Marie Mercier, veuve d’un Communard fusillé par les Versaillais, qu’il prendra d’abord à son service et prendra ensuite dans son lit.
Toujours serviable avec les dames, après avoir exprimé toute sa compassion à une dénommée Jeanne Gigoux, domestique au chômage et SDF qu’il a accepté de rencontrer, il n’écoute que son bon cœur et n’hésite pas une seconde : « elle est sans asile, j’ai dit qu’on la logeât et qu’on la nourrit chez moi quelques jours jusqu’à ce qu’elle ait une place ». Peu après cet acte généreux il note dans son carnet : « J.G. secunda vez » (seconde fois). « Elle n’avait pas de lit, il lui en a trouvé un, le sien ! » commente son biographe (De Decker 234). Chez Hugo, la lubricité se cache derrière la charité et le prédateur avance sous le masque du bienfaiteur. Et on observe chez lui cette stratégie typique des faux alliés : se présenter en ami des femmes, en protecteur de leur faiblesse et en défenseur de leurs droits pour, en leur inspirant confiance, attirer des proies vulnérables dans ses filets.

CONSTAT D’ADULTERE
On le voit, Hugo a pratiqué l’adultère sur une grande échelle, ce qui peut se révéler périlleux. Et en effet, si cette habitude n’a pas entraîné de conséquences désagréables pour lui la plupart du temps —sa femme avait pris de bonne heure l’habitude de fermer les yeux, contente d’être ainsi débarrassée des assiduités importunes de son mari, tandis que Juliette était le plus souvent laissée dans l’ignorance—il y eut tout de même une fois où ses frasques défrayèrent la chronique : la jeune (22 ans alors qu’il en avait presque 40) Léonie Biard qui avait attiré son attention était mariée à un peintre également plus âgé qu’elle, François Biard, fort jaloux, et que son cocuage flatteur par un écrivain célèbre n’enchantait pas. Hugo rencontrait initialement la blonde Léonie dans la maison familiale, qu’il avait fait aménager de façon à pouvoir recevoir discrètement ses invitées : un escalier dérobé menait à sa chambre/bureau.
En fait de discrétion, ce n’était pas vraiment concluant : les amants se montraient parfois si bruyants que les domestiques, et même Adèle, venaient « tambouriner à la porte de son « cabinet de travail » pour les rappeler à l’ordre et leur signifier d’avoir à modérer leurs transports. Cela finissant par devenir gênant, Hugo décida de louer un nid d’amour où ils pourraient s’aimer bruyamment en toute tranquillité : il trouva une chambre meublée, juste un lit sous les toits, dans le passage Saint-Roch. Mais là, ce ne fut pas Adèle qui vint tambouriner à la porte, ce fut « un commissaire de police en écharpe » suivi du mari trompé et furieux. Et là on passe de la poésie à la comédie de boulevard :
-« Au nom du roi, ouvrez ! »
-« Ciel mon mari ! »
Hugo et Léonie se rhabillent à la hâte, tandis que le commissaire leur annonce que, coupables d’adultère, ils sont passibles de prison. Hugo proteste : il rappelle son statut de pair de France qui lui garantit l’inviolabilité et argue qu’il ne peut de ce fait être jugé que par la Haute Assemblée. Il sort libre, tandis que la malheureuse Léonie est emmenée et jetée en prison, à Saint Lazare où étaient enfermées les prostituées. Elle « y croupira pendant deux mois » et le scandale sera énorme. Les journaux s’en donnent à cœur joie et brocardent le grand homme adultère, « l’inviolable qui viole (…) la loi » et des mauvais esprits font des jeux de mots douteux sur la déplorable aventure « d’une célèbre paire de France » (De Decker 158-159). Il ne lui rendra pas visite en prison mais lui enverra généreusement sa femme.
L’intelligente et compréhensive Adèle, la « sainte femme » comme la nommait Hugo, se dévoue pour mettre fin au scandale : elle s’aventure à la prison Saint-Lazare parmi les « filles publiques », paie pour que Léonie bénéficie de conditions de détention confortables et contacte la duchesse Hélène, belle-fille du roi Louis-Philippe, qui apprécie le poète. Le mari trompé qui continue à faire du grabuge est convoqué par le roi lui-même, qui le complimente sur ton talent et lui commande une série de fresques pour le palais de Versailles : message reçu, le mari accepte le deal et retire sa plainte, l’épouse infidèle peut sortir de prison et est transférée dans un couvent où elle restera plusieurs mois. Des plaisantins commentent que les fresques du roi ont fait oublier à Biard les frasques de sa femme (De Decker, 159-160). Léonie, peu rancunière, restera en contact charnel avec Hugo pendant des années et aurait eu un enfant de lui.
ADELE H.
L’étrange histoire d’Adèle H. a inspiré Truffaut : Adèle, c’est cette jeune femme érotomane qui, s’étant persuadée qu’un militaire anglais, Albert Pinson, était amoureux d’elle et voulait l’épouser, le poursuivit dans le monde entier pour l’obliger à tenir un engagement de mariage qu’il n’avait jamais pris. Façon d’échapper à l’étouffante emprise paternelle, cette chimère matrimoniale l’obsède pendant des années : un jour, le 18 juin 1863, Adèle, jeune fille très surveillée, disparaît de la maison familiale de Guernesey ; Hugo pense qu’elle est partie pour Paris et s’afflige de ne pas recevoir de ses nouvelles : « mon père est accablé de l’indifférence de ma sœur, il pense qu’elle le hait » écrit François-Victor », son frère. « Et il n’avait pas tout à fait tort ! » commente de Decker (De Decker 226).
Trois mois plus tard, Hugo reçoit une lettre en provenance du Canada, de Halifax en Nouvelle Ecosse : c’est Adèle qui lui annonce qu’elle est allée rejoindre le lieutenant Pinson, affecté avec son régiment dans cette partie du monde, et qu’ils sont mariés. En fait, Adèle a menti, ils ne sont pas mariés, et Pinson n’a toujours aucune intention de l’épouser. Pendant neuf ans, Adèle poursuivra Pinson de garnison en garnison ; finalement échouée à la Barbade alors que son état mental s’était considérablement dégradé, elle sera prise en charge par une Barbadienne charitable, Céline Alvarez Baa, qui la recueillera et la ramènera à son père en 1872 (il la placera dans une maison de santé). Hugo, qui ne rate pas une occasion, couche avec Céline Baa, notant au passage, toujours en langage crypté, que c’est sa première Noire : « la primera negra de mi vida » (De Decker 273).
LEOPOLDINE ET JEANNE
Enfin il y a la relation de Hugo avec Léopoldine, jeune mariée morte noyée alors qu’elle se promenait en bateau sur la Seine avec son mari, « une relation proche frisant l’anormalité », un climat incestuel installé autour de la première de ses deux filles dont « il se serait approché au point de commettre l’inceste », cette proximité excessive ayant suscité des rumeurs ( Bassalah 27). Léopoldine, morte alors qu’elle venait de réussir à échapper au joug paternel en se mariant, mariage que Hugo a refusé pendant cinq ans avant de consentir—« elle était trop jeune ». A la lumière de ces rumeurs et du vif intérêt d’Hugo pour les Lolitas, le fameux « Art d’être-grand père », œuvre tardive de l’écrivain (1877) qui célèbre son amour pour ses petits-enfants et la joie que lui apporte leur présence–en particulier celle de la petite Jeanne, fille de son fils Charles—prend une résonnance inquiétante. C’est pourtant de ce recueil, censé célébrer les joies de la famille donc apparemment parfaitement recommandable, dont les instituteurs de la 3ème et 4ème République ont tiré d’innombrables poèmes qu’ils ont fait apprendre à des générations d’élèves : qui ne connait pas le fameux « Lorsque l’enfant paraît » :
« Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris ; son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,
Se dérident soudain à voir l’enfant paraître,
Innocent et joyeux. »
Un peu gnangnan, non ? Pas tant que ça en fait : à qui sont ces « fronts souillés », et par quoi ? Une chose est sûre, selon les biographes : les sentiments de Léopoldine et d’Adèle envers leur père semblent avoir été des plus mitigés.
LE CREPUSCULE D’UN FAUNE
Rien n’y fait, les années s’accumulent sur la tête chenue du vieux faune mais il continue à fréquenter des prostituées et à explorer le « ravin » des servantes. Juliette veille au grain et essaie de limiter les dégâts : elle n’en peut mais et doit s’accommoder des innombrables passades du libidineux génie mais ce qu’elle ne veut à aucun prix, c’est qu’il ait un coup de cœur pour une de ces étoiles filantes et se prenne pour elle d’une passion sénile. Elle se faufile en douce dans son cabinet de travail pour lire ses carnets où la kyrielle des prénoms s’allonge : Zélie, Eugénie, Jane, Louise, Suzanne, Albertine, Angélique, Nina, Augustine, Judith (Gauthier, la fille de Théophile Gauthier, avec qui il aura une liaison qui durera jusqu’à ses 80 ans), elle espionne ses déplacements, ses rencontres, elle essaie de convaincre ses relations de le suivre et de lui rendre compte de ses activités. Hugo va vers ses 80 ans, et la plupart de ses partenaires ont au moins 50 ans de moins que lui. Cette activité sexuelle frénétique que lui envieraient des hommes jeunes, il regrette qu’elle ait quand même un peu diminué, il n’est plus tout à fait l’homme qu’il a été, reconnait-il à regret : « faire un discours, ça me fatigue comme de faire l’amour quatre fois » (De Decker 274).
Juliette se défend comme elle peut, essaie de recruter des servantes dont la pureté, la virginité, les valeurs religieuses et morales, certifiées par ses amies, lui paraissent garantir qu’elles ne finiront pas dans le lit du grand homme : elle fait entrer le mouton dans la louverie en engageant une jeune fille de 22 ans, Blanche, qui assurera aussi un travail de copiste des manuscrits d’Hugo. Blanche inéluctablement succombe, et Juliette en a la confirmation en lisant le carnet ou Hugo n’a pas fait beaucoup d’efforts pour crypter l’identité de sa dernière conquête : il l’a surnommée « Alba ». Juliette se rebelle encore une fois et lui pose un ultimatum : « c’est elle ou moi ». Lâche, Hugo met Blanche dans le prochain bateau pour la France et il proteste de la profondeur de ses sentiments pour sa « vieille maîtresse d’école » comme il l’appelle galamment. Mais ce n’était qu’une mise en scène, Blanche a fait semblant de s’embarquer mais elle est subrepticement revenue à terre. Et s’est installée avec armes et bagages dans un petit appartement que Hugo lui a loué et où il va la retrouver tous les jours : de nouveau, on est dans la comédie de boulevard.
Mais il s’inquiète d’avoir été reconnu par des connaissances en sortant de leur repaire : il envoie Blanche à Paris pour de bon et la rejoint quelques jours après dans la pension de famille où elle réside avenue de La Motte-Picquet (De Decker 283). Leur liaison durera jusqu’aux 78 ans de l’écrivain, et il lui fait des scènes de jalousie s’il la voit seulement parler à un homme. Cependant, les déplacements parisiens de Toto finissent par mettre la puce à l’oreille de Juliette : elle veut en avoir le cœur net et engage une agence de détectives pour le filer, et ce qui lui est rapporté ne lui laisse aucun doute sur son infortune. Une fois de plus, c’est la grande scène de rupture, rôle dramatique qu’elle maîtrise parfaitement puisqu’elle l’a joué une dizaine de fois : « Adieu pour jamais, adieu pour toujours » écrit-elle (De Decker 285). Elle part pour Bruxelles, et puis elle revient, Victor l’attend à la gare. Et dès son retour, il lui jure de renoncer définitivement à Blanche, il le jure sur la tête de son seul fils survivant, François-Victor. Malencontreusement, François-Victor meurt peu après.
La culpabilité que ressent Hugo ne l’empêche pas de continuer à voir Blanche, qu’il a revue le surlendemain même de ses serments d’amour éternel à Juliette : de nos jours, on diagnostiquerait chez lui une addiction au sexe, et certains ont prononcé à son sujet le mot de « satyriasis ».
Mais un événement survient qui change la donne : en 1878, Hugo a un petit AVC, il part se refaire une santé à Guernesey et Juliette l’accompagne, espérant que cet accident cérébral le calmera. Vain espoir : Victor continue à fréquenter le bordel de Guernesey et à forniquer avec la servante Augustine. Son médecin l’avertit : s’il continue à coïter comme un cerf en rut, il va mourir. Mais cela n’arrête pas l’incorrigible, les prénoms s’ajoutent aux prénoms dans son carnet, et il fréquente toujours Blanche, cette voleuse de santé : Juliette, en colonisée typique, considère que si Victor la trompe avec une ribambelle de coureuses et d’intrigantes, c’est parce qu’il est faible et trop gentil, et que ce sont ces gourgandines qui le provoquent et vont le tuer en le poussant à la luxure. Désespérée, désormais presque impotente, elle va voir Blanche et, lors d’une entrevue qu’on imagine houleuse, lui explique qu’elle tue Hugo à petit feu et que si elle ne renonce pas à leurs étreintes, il pourrait —scandale énorme—mourir entre ses bras, entre ses draps. Blanche a peur d’être impliquée dans une affaire aussi sordide et Hugo capitule : il la congédie, non sans lui avoir fait remettre la royale somme de 500 Francs.

Dans sa famille, qui jusqu’alors a couvert les égarements du personnage, certains commencent à trouver son érotomanie sénile intolérable (Kahn 151) : Edouard Lockroy, le second mari de sa bru (Alice, la femme de son fils Charles décédé) et ministre sous la 3ème République, lui intime de mettre un frein à sa lubricité : « En voilà assez de vos frasques, vous m’entendez ! Laissez la cuisinière tranquille, et si vous voulez pincer des fesses, allez les pincer hors d’ici. Respectez votre bru et vos petits-enfants ! » Un peu plus tard, alors qu’il le croise en chemise de nuit dans l’escalier qui mène aux chambres de bonnes, il le tance : « où allez-vous encore, vieux dégoûtant ? Vous croyez-vous au bordel pour circuler dans une tenue pareille ? » (De Decker 299). Ce « vieux dégoûtant » qui rend visite aux domestiques en chemise de nuit est académicien, sénateur, pair de France, objet d’une immense adulation collective dans son pays et à l’étranger, l’écrivain le plus lu dans le monde… L’assistance aux séances de l’Académie française ou sa présence requise au Sénat lui fournissant une excellente excuse pour aller au bordel sans alerter Juliette… Edouard Lockroy lui, n’est pas dupe, il sait ce que cache la glorieuse image de l’auguste vieillard : il déclarera un jour, devant témoins, que Hugo est « un insupportable tyran et une vraie brute » (De Decker 305).
Juliette part enfin pour de bon : elle meurt le 11 mai 1883. Elle ne verra plus les croix qu’Hugo continue à inscrire sur son carnet. Il entame une dernière liaison amoureuse avec la princesse russe et poétesse Tola Dorian, amie de sa bru Alice, la veuve de son fils Charles, qu’il poursuivit aussi de ses assiduités . Il meurt en 1885, le jour de la sainte Juliette.
Mais pourquoi révéler les sordides débauches hugoliennes ? Ne vaudrait-il pas mieux garder nos illusions sur l’illustre écrivain et faire ce que sa famille a fait pendant des lustres, les ignorer ? Séparer l’homme de l’artiste ? Le problème est qu’Hugo n’est pas seulement un artiste, c’est un auteur engagé, militant qui a mis très publiquement sa célébrité au service de la défense de diverses causes progressistes : la République, le droit du peuple à l’instruction, au travail et à une vie décente, la lutte contre la pauvreté. Et au service des droits des femmes et de la dénonciation de la prostitution, esclavage moderne.
Comment peut-on accorder une quelconque crédibilité aux propos en faveur de l’émancipation des femmes tenus par un homme qui les tyrannisait, qui les séquestrait, les exploitait et les violait (y compris des très jeunes filles) dans le cadre de sa famille et de ses innombrables liaisons et aventures sexuelles ? Comment peut-on prendre au sérieux les dénonciations de l’esclavage prostitutionnel d’un client assidu des bordels ? Comment croire à la sincérité des déclarations sur l’éminente dignité du peuple et sur la protection due aux faibles d’un grand bourgeois qui profitait de la pauvreté et de la vulnérabilité sociale de certaines catégories de femmes—servantes, actrices débutantes, Communardes –pour leur extorquer des relations sexuelles ?
Hugo n’est pas, comme Flaubert, purement un littérateur, c’est aussi un homme politique, un militant, un idéologue et comme tel un prescripteur de morale : c’est au nom de la justice et de l’éthique qu’il prend les postures progressistes rappelées ci-dessus. En violant dans sa vie privée ce qu’il prescrit publiquement, selon la formule éprouvée du « faites ce que je dis, pas ce que je fais », Hugo discrédite les causes qu’il défend, les ravale au niveau de simples gesticulations de poseur, les réduit à un affichage de vertu mis en scène par un hypocrite pour dissimuler ses turpitudes. Ce faisant, il jette le doute sur leur légitimité, jactance mensongère, brassage de vent, fariboles d’un faiseur de phrases. Et en vérifiant ainsi objectivement le point de vue des conservateurs sur le « tous pourris » et sur le caractère fallacieux des propositions progressistes, Hugo valide par contrecoup le sérieux et la crédibilité de ses adversaires politiques.
Il n’est pas possible de cesser de lire et d’étudier en classe tous les auteurs qui ont été des violeurs, des violents, des incestueurs, des pédocriminels, des harceleurs et des acheteurs de sexe : si l’on appliquait ces restrictions à la lettre, il ne resterait pratiquement rien de notre patrimoine littéraire. Mais en tant que féministes, il est spécialement exaspérant de voir érigés en professeurs de morale, en modèles d’intégrité, d’humanisme et de progressisme des personnalités—comme Hugo, Ghandi, Tolstoï, et quelques autres– dont le comportement avec les femmes relève, selon les standards de notre époque et même de la leur, de la pure et simple criminalité.
BIBLIOGRAPHIE
Bassalah, Iman, « La vie sexuelle des écrivains ».
Besson, André, « Victor Hugo, vie d’un géant ». France-Empire, 2001.
De Decker, Michel, « Hugo, Victor pour ces dames ». Belfond, 2002. Nouveau monde éditions, 2016.
Gourdin, Henri, « Les Hugo ». Grasset, 2015.
Kahn, Jean-François, « Victor Hugo, un révolutionnaire ». Fayard, 2001.
Murie, Yves, « L’Enfant de la Vierge Rouge ». L’Harmattan, 2002.
Novarino, Aline, « Victor Hugo, Juliette Drouet : dans l’ombre du génie ». Belfond, 2000.
Troyat, Henri, « Juliette Drouet ». Flammarion, 1997.